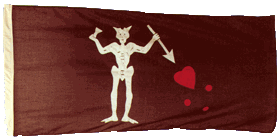 |
Mi-diable, mi-squelette, tenant un sablier et pointant une lance vers un coeur rouge. Jolly Roger, nom anglais du pavillon pirate, vient peut-être du terme français désignant le drapeau "Sans quartier", "Le Joli Rouge"

Son pavillon possède le crâne et les deux os croisés des pavillons pirates conventionnels.

Le sablier est un emblème courant sur les pavillons pirates. Sur celui de Moody, tout comme sur de nombreuses tombes, le sablier a des ailes pour accentuer l'idée de la fuite rapide du temps. Celui que les pirates offraient à leurs victimes pour se rendre ne manquait pas à la règle.

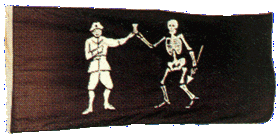
Il avait choisi de boire avec la Mort. Mais son second pavillon montrait deux crânes marqués l'un ABH, "A Barbadian Head", l'autre AMH, "A Martinican Head", en référence au serment qu'il s'était fait de se venger des habitants des deux îles des Caraïbes qui avaient osé se dresser contre lui.


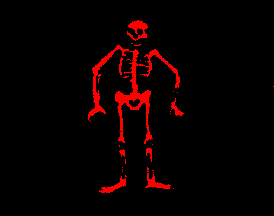

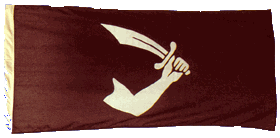
Le sabre a toujours symbolisé la force. Thomas Tew l'avait adopté pour son pavillon. Mais était-ce le bon choix que ce cimeterre, puisque ce fut un sabre de ce type qui lui coupa la tête lors de son attaque du navire indien Futteh Mahmood en 1695.